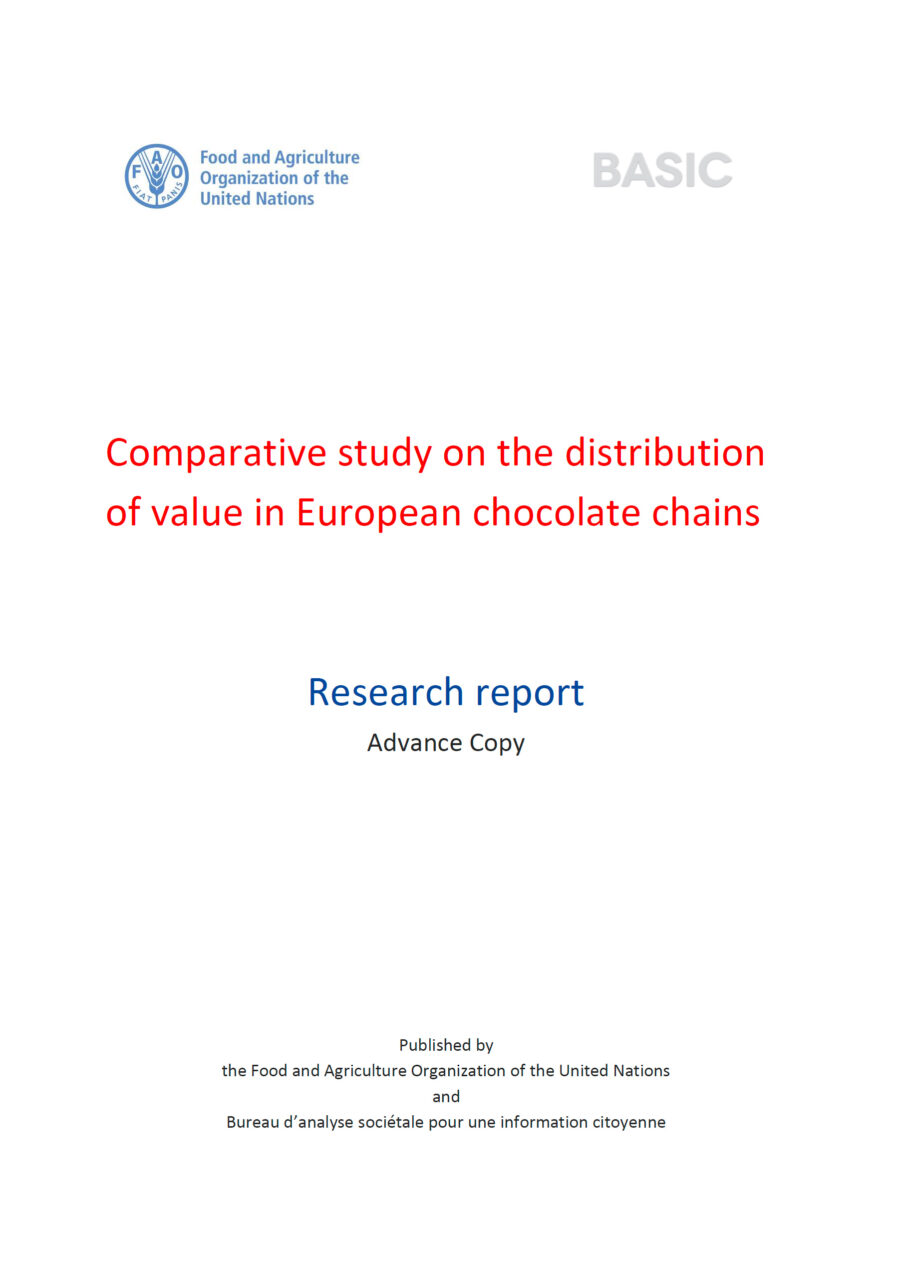Étude comparative de la répartition de la valeur au sein des filières européennes de cacao-chocolat
publié le 30 juin 2020Cette étude investigue le marché français des tablettes de chocolat noir et lait, ainsi que celui des poudres cacaotées pour petit déjeuner et des barres chocolatées vendus en supermarchés – fabriqués à partir de fèves de cacao cultivées en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Équateur et au Cameroun – dans le but de fournir des estimations de la répartition de la valeur, des coûts, des taxes et des marges le long des différents maillons de la filière cacao/chocolat.
Demandeur(s)
- Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne (DG INTPA)
- Centre d'investissement de l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)
- Association européenne pour le cacao